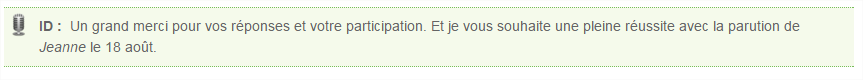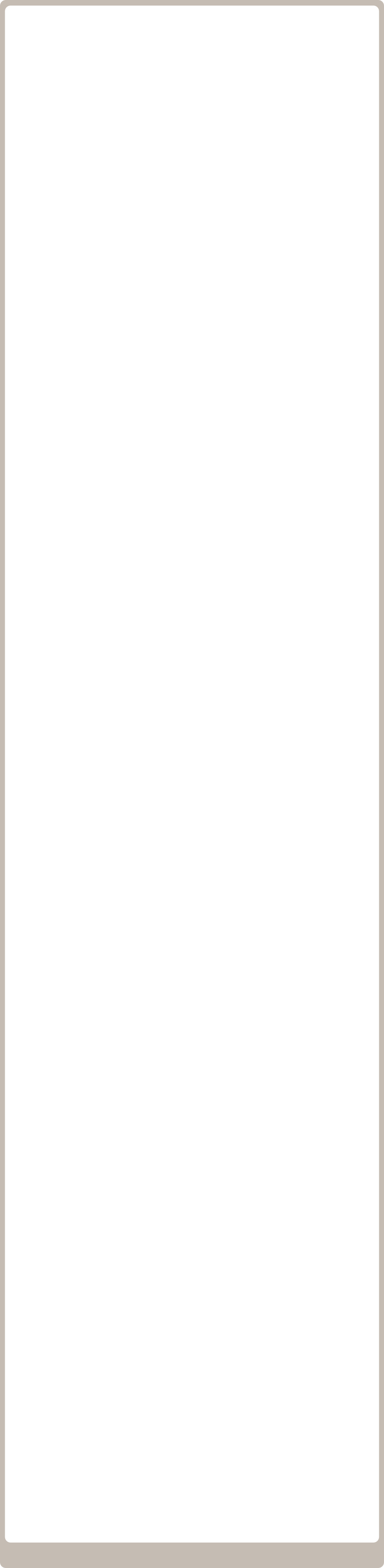
Copyright © 2010 Site officiel de Jacques Cassabois. Tous droits réservés
Site créé par Judith DELVINCOURT et administré par Martine POGNANT
Maj le 13/10/2022

JC : Oui beaucoup. Comme à mon habitude depuis que j’écris. Je m’efforce de tendre vers la simplicité et la sobriété et je n’y parviens jamais spontanément. Je compense donc mon absence d’aisance naturelle par les heures à la table. Mais avec JEANNE, je dois vous avouer que je suis monté d’un cran, aussi bien dans l’organisation que dans la rigueur.
Dès que j’ai eu le feu vert de mon éditrice pour écrire un roman sur Jeanne, la nouvelle tonalité s’est imposée. Je la résumerai d’un mot : économie, qui s’est appliqué dès le départ, au choix de la collection qui accueillerait le livre. Le Livre de Poche Jeunesse. Pas Black moon. À cause du prix de vente.
En effet, si les ados sont prêts à dépenser 15 ou 16 euros pour acquérir un pavé mariné dans une sauce à l’hémoglobine, ils ne les dépenseront jamais pour un roman sur Jeanne d’Arc qui est le cadet de leurs désirs et qui de surcroît leur rappellera l’école. Donc, si nous voulions avoir des chances que mon livre soit acheté, il fallait commencer par le positionner, pour utiliser un terme de marketing, à la bonne place, en tirant son prix de vente vers le bas et ce, indépendamment de toute appréciation sur son contenu. Autrement dit, respecter l’évidente contrainte de la réalité du marché. On accepte le deal ou on le refuse !
Moi, il me plaisait infiniment. J’aime bien les conditions claires et strictes. Elles définissent le champ d’exercice de ma liberté et je n’avais pas du tout envie d’en discuter les termes. Au contraire, je les reprenais à mon compte sur le mode : « Quitte ou double, mon pote ! Est-
C’est moi qui ai posé la question suivante à Cécile Térouanne, pour continuer de cerner mes contraintes.
— Quelle longueur, le texte ?
Car la longueur qui détermine le nombre de pages du livre induit son prix de revient, donc son prix de vente. Nous voulions rester dans une gamme bon marcé pour abaisser les obstacles à l’achat comme je l’ai dit et nous étions portés également par un évident souci de démocratisation du livre et de la culture. Souci dynamique. En action. Pas en blabla ! Autour de 5 euros pour être précis.
C’est ainsi que Cécile, après avoir évalué rapidement son budget de fabrication, m’a répondu en guettant ma réaction : — Trois cent mille signes. Ça te va ?
— OK !
J’étais soulagé. J’avais craint que ce fût moins.
Ensuite, nous avons défini mes délais d’écriture, ce qui n’est jamais un problème (je mets les bouchées doubles avec des semaines de 80 heures et je suis toujours en avance), puis je suis rentré chez moi avec mon cahier des charges sous le bras pour me mettre au boulot.
Voilà en gros comment a débuté JEANNE.
Ensuite, la mer immense ! Le vent du large, la houle et les tempêtes, les hauts-
Je me suis renseigné sur le personnage , impatient de faire mieux sa connaissance et d’emblée, j’ai été bien servi par le hasard. Le premier livre que j’ai acheté et qui allait devenir mon référent était le magnifique JEANNE D’ARC de Colette Beaune (Perrin, 2004), puis, un peu après, j’ai acheté le CHARLES VII de Philippe Erlanger (Gallimard, 1981).
Je ne détaillerai pas davantage ma documentation qui se trouve en annexe de mon livre, pour mieux rester dans votre question et vous parler d’écriture.
Assez rapidement, j’ai défini le plan du roman. La vie de Jeanne l’imposait : huit grandes parties, centrées sur les villes emblématiques de son itinéraire et développées en un nombre de chapitres qui me paraissaient nécessaires pour raconter les événements qui s’y sont déroulés. Un premier découpage à l’intuition, qui s’est affiné en cours d’écriture, mais qui n’a pas trop varié. Ce découpage m’était indispensable pour morceler le volume total des trois cent mille signes et l’apprivoiser.
J’ai ainsi défini 24 unités narratives (ce qui mettait chacune à 12500 signes), nombre que j’ai ensuite ramené à 20, pour me donner un peu d’air (15000 signes par chapitre, que j’ai aussitôt réduits à 13000 afin de pouvoir moduler). 20 fois 13000 égal 260000. Sur 300, cela me laissait un peu de marge, mais j’aimais autant me serrer la vis au départ, me doutant que mes repères allaient bouger et me réservant d’alterner, le cas échéant, des chapitres brefs avec d’autres plus développés.
Ce souci du calibrage m’a accompagné tout au long de mon travail, jusqu’à l’obsession. Il m’a aidé à faire les premiers choix, comme celui du temps du récit : le présent de l’indicatif qui s’est imposé immédiatement. Un temps vigoureux, coloré, abrupt parfois, qui vous pousse vers une scansion rapide, haletante. Les phrases longues sont difficiles avec lui. Il réclame de la précision, de la simplicité. J’aime beaucoup le présent. Je l’ai découvert en écrivant SINDBAD LE MARIN, puis utilisé pour LE PREMIER ROI DU MONDE, ANTIGONE, TRISTAN ET ISEUT, notamment. C’est le temps des pieds sur terre, du contact avec la réalité. Il est vert et acide. Les contre-
Ensuite, lorsque j’ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que ce choix du présent était parfaitement en phase avec la personnalité de Jeanne, sa candeur, sa franchise, son culot. Que le feu roulant narratif qu’il m’imposait était absolument à l’unisson de la fulgurance avec laquelle elle a conduit sa mission.
Chaque fois que j’avais terminé un chapitre, je vérifiais que j’étais dans mon gabarit, combien de signes je gagnais ici, que je pouvais récupérer là, pour des scènes qui avaient besoin d’être plus développées. Je me référais également à ma feuille de route générale au moment où j’organisais le contenu des chapitres. Je définissais ce qu’il était indispensable de dire et que je devais impérativement détailler, ce qui était secondaire et pouvait être suggéré en une phrase, voire en une allusion de quelques mots, en ayant le calibrage présent à l’esprit. J’établissais des listes de ces situations où je ne pouvais m’attarder et j’essayais de les caser, dans la chronologie adéquate, d’une façon impressionniste, avec légèreté, comme des ponctuations.
Je me suis vite habitué à ce régime sec, un peu tendu, un peu frustrant, car il y avait évidemment des situations, parfois, où j’aurais aimé m’attarder. Mais au cours du travail, je me suis rendu compte que la contrainte éditoriale, qui générait ma contrainte d’écriture devenait le souffle même de mon travail, m’encourageait à une exigence de tenue, qui faisait écho à la droiture de la femme dont je racontais la vie.
Cécile Térouanne suivait ma progression, chapitre après chapitre et me ramenait dans les clous quand je m’en écartais. Ma femme aussi, première lectrice, dont les avis que je ne suivais pas toujours, étaient immédiatement confirmés par ceux de Cécile.
À Montreuil, fin novembre 2009, Charlotte Ruffault qui n’était pas dans le quotidien de mon travail, envisagea, après que je lui eus raconté où j’en étais (à peu près aux deux tiers du roman) de quitter le poche pour publier en hors collection. Ma réaction a été immédiate : non ! Je ne voulais pas changer notre fusil d’épaule. J’en avais discuté avec Cécile et nous étions d’accord là-
Je n’avais pas envie de quitter cette sorte d’ascèse d’écriture à laquelle me contraignait Jeanne. Je me sentais plus proche d’elle. Et puis, quand vous avez l’habitude d’un certain maintien, même si vous n’avez plus envie de vous avachir, vous vous méfiez tout de même du confort. Quand on retrouve de la place, on risque d’avoir envie de s’étaler. C’est ainsi qu’on prend du gras. Or, je m’efforçais d’être affûté et je voulais le demeurer.
Quand j’ai eu terminé, j’arrivais à 310 000 signes. Comme Cécile m’avait accordé une rallonge de 15000 pour me tranquilliser, j’étais dans mon calibre.
Et c’est alors que nous avons relu, pour établir la copie définitive qui allait être passée au correcteur. Françoise, ma femme, a relu, j’ai relu (mais à ce point du travail, je ne valais plus grand chose), Cécile a relu, et Charlotte et Antoinette Rouverand, la directrice marketing. Toutes ont donné leurs avis, leurs indications et j’ai repris mon texte pour arbitrer, apprécier ce qui était effectivement inutile et ralentissait le récit, ce qui restait encore à clarifier, supprimant des phrases, reprenant entièrement certaines pages, restant ferme sur telles ou telles formulations.
Ce n’est pas le moment le plus agréable du travail, car vous êtes tellement immergé dans votre sujet, tellement habitué à la sonorité des phrases que vous avez lues et relues au moment où vous les écriviez, que votre oreille a du mal à se faire à de nouvelles sonorités et que vous avez tendance à ressentir les suppressions comme des arrachements.
Je vous rassure tout de suite (car j’ai entendu dire que le sujet revenait au premier rang des préoccupations de certains), jamais je n’ai pris cela pour cette fameuse censure qui exaspère tant les belles âmes. Non, jamais. Pour moi, c’était un toilettage de mon texte. Une chance supplémentaire, offerte par celles qui m’avaient lu avec attention, de transmettre avec plus d’efficacité cette vie incandescente de JEANNE à des jeunes du XXIè siècle. Et, même si, au cours de cette période, je me suis parfois trouvé découragé, au point d’avoir envie d’abandonner, j’ai remercié celles qui me donnaient cette chance.
(Par ailleurs, si vos lecteurs sont intéressés de savoir comment l’idée de ce roman m’est venue, ils trouveront la réponse à cette question, posée par une jeune blogueuse, sur mon site, ici.)
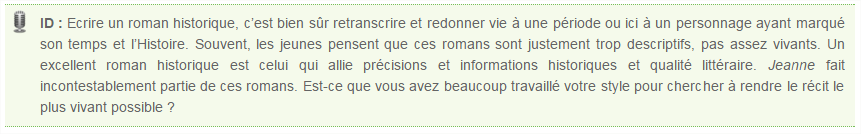
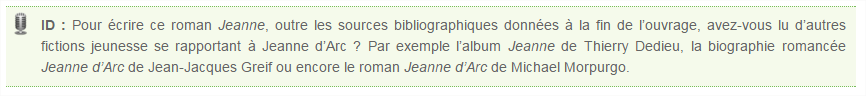
JC : Non aucune fiction. Ni en littérature pour la jeunesse, ni en littérature générale. Je refuse catégoriquement. Je n’ai pas davantage visionné les films de Dreyer, Delannoy, Rivette, ni non plus celui de Besson que j’avais vu à sa sortie alors que je ne connaissais rien de Jeanne et que je me suis bien gardé de revoir.
C’est une habitude érigée en principe. Autant je remonte aux sources, recherche les études des historiens, des érudits et leurs analyses, autant je fuis les interprétations de mes confrères. Je me protège, car je suis trop influençable, trop facile à déstabiliser. Dans la version d’un autre, je vois immédiatement les qualités qui mettent le travail hors de ma portée. À l’inverse, je ne vois chez moi que les défauts qui m’empêcheront d’aboutir le projet. Et puis quand j’ai lu la version d’un autre, je ne peux plus l’oublier et elle me gêne pour créer. Si j’essayais de passer outre, j’aurais l’impression de plagier.
Quand je commence un livre, je ne sais pas grand chose. Le chemin n’est pas tracé. Je l’invente à mesure que je progresse et souvent en aveugle.
Les gens ont souvent du mal à comprendre cela. La perception d’un livre n’est pas la même quand on est lecteur prêt à consommer ou auteur à l’attaque de sa paroi. Dans le premier cas, la table est servie. Dans le second, on n’a pas encore trouvé les ingrédients et on ne sait pas toujours où aller faire son marché.
Et puis, il y a une autre raison, toute rutilante des feux de l’orgueil. Je vous la donne parce qu’elle fait partie de mes outils de travail. Chaque livre est un défi et j’ai la prétention de croire que je vais réussir une version que personne n’a encore faite. Originale et personnelle, même si je sais bien que tout a été dit depuis longtemps et que nous nous bornons souvent à répéter. C’est un simple défi de créateur et ma prétention, toute provisoire, m’a permis d’aborder Gilgamesh que j’ai écrit deux fois, pour les adultes et pour les jeunes, Sindbad, Tristan et Iseut, Antigone et Jeanne.
Ensuite, quand le livre est achevé, la prétention disparaît et je redescends sur terre.
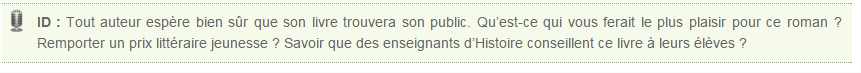
JC : Ce qui me ferait le plus plaisir, c’est qu’il soit lu, que les ados découvrent Jeanne, qu’elle les surprenne, qu’ils puissent l’admirer, s’en faire un modèle. Oui, un modèle. On a besoin de modèles pour se construire. Besoin de rêver en admirant le vol des grands oiseaux avant de s’élancer soi-
Quand le livre sera sorti, tous les moyens seront bons évidemment pour le faire connaître. Les prix littéraires en sont un excellent, mais ce n’est pas moi qui décide. S’il se fait remarquer, les enseignants d’histoire auront peut-

JC : Oui, bien sûr. Et plus d’un. Mais je préfère ne pas en parler. Les projets n’ont d’intérêt que lorsqu’ils sont réalisés.