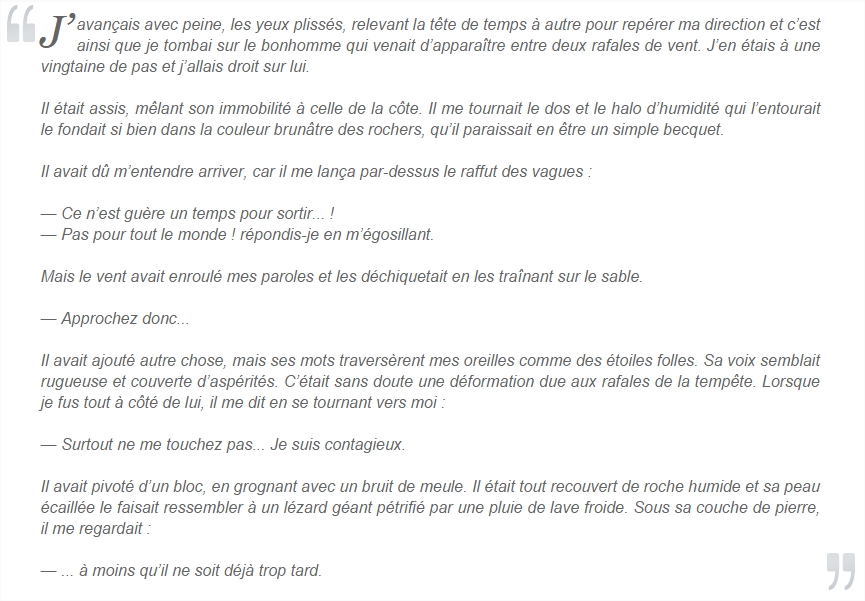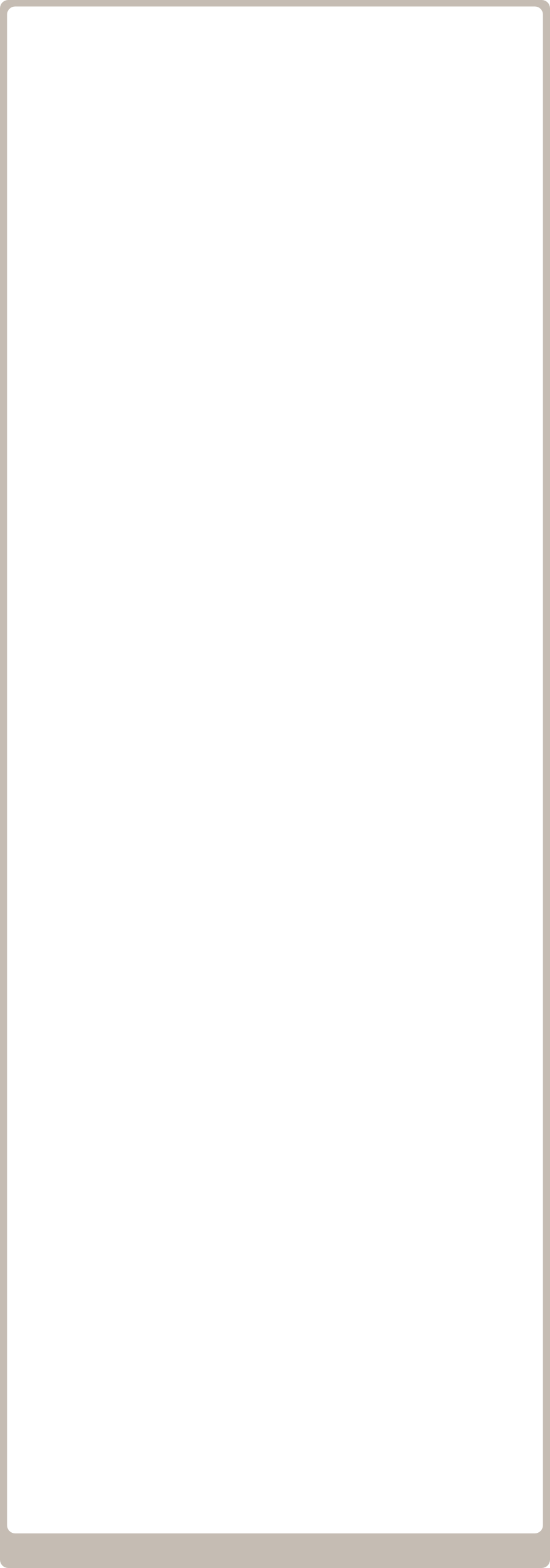
Copyright © 2010 Site officiel de Jacques Cassabois. Tous droits réservés
Site créé par Judith DELVINCOURT et administré par Martine POGNANT
Maj le 29/12/2024
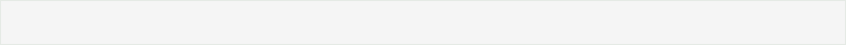
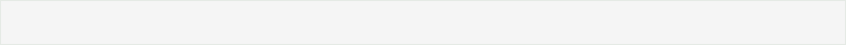

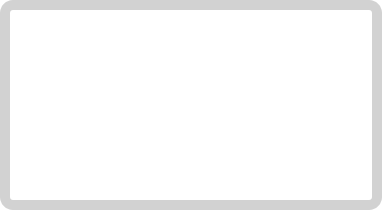
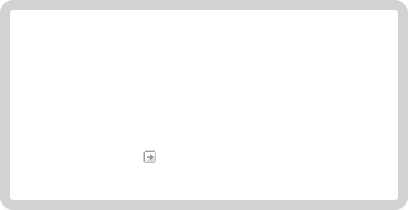

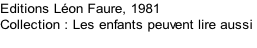




Réédition en 1985, par La Farandole
Couverture de Frédéric Clément


 homme de pierre, mon frère granitique, est né avec moi, en 1947, sur le premier plateau jurassien.
homme de pierre, mon frère granitique, est né avec moi, en 1947, sur le premier plateau jurassien.
Une année de sécheresse où la terre tombait en poudre, où le calcaire des falaises étincelait de lumière bleue. Cette année-
Nous sommes nés, lui et moi, en pleine saison des vendanges.
Dans la maison de la sage-
Ma mère, elle, avait couché à ses côtés, une saison de foins et de moissons, de sueur et de poussière qui détrempaient sa peau et ses linges, et, pour répondre à la stature imposante des sapins, elle avait apporté la charmille et le foyard, le buis, le cytise, le tilleul, le plane blanc et tous les bois qui chantaient dans sa tête sous le fer des gouges et des bédanes.
Bois lisses des petits objets de la tournerie, bois rugueux des gros œuvres, écorchés par les scies à ruban.
Nous avons grandi, l’homme de pierre et moi, sur ces terres et dans ces bois où il fallait se tenir à l’écart de l’eau.
L’eau tolérée, vénérée parce qu’elle désaltérait les hommes, les bêtes, les terres, parce qu’elle entraînait les turbines des minoteries ou des scieries.
L’eau, outil de travail, force motrice. Cette eau-
L’eau des cascades semblait trop volage, celle des lacs trop étrange, et l’on sentait bien à fréquenter leurs berges incertaines qu’une force obscure se dégageait de ces eaux sombres, une force occulte qui embrouillait le regard et entraînait les pensées dans les labyrinthes humides du rêve.
Certains, même, aux beaux jours, n’hésitaient pas à se dévêtir pour se tremper dans ces eaux-
Je ne savais pas nager. Je n’ai appris que très tard, gauchement. Je n’aimais pas l’eau. La vie était trop sérieuse pour mériter de s’acoquiner avec une telle compagne. Il fallait s’établir dans des réalités plus stables, suivre l’exemple des forêts, et, comme elles, s’enraciner dans la maigre terre qui recouvrait difficilement leurs pieds.
L’homme de pierre me suivait, tel un compagnon discret.
C’est lui qui me guidait en été, vers les buissons de saules qui bordaient la rivière, qui m’y ramenait en hiver quand le courant se laissait figer sous la glace, ou au printemps, lorsque les crues charriaient leur révolte.
L’homme de pierre s’est longtemps nourri en cachette de toutes les eaux que j’ai pu voler.
Parmi celles-
J’ai appris les caps avec leurs drôles de blanc ou de gris nez, les golfes, les baies, les presqu’îles et les côtes découpées, avec ferveur et assiduité.
Souvent, le soir, entre la traite des vaches et l’heure de la soupe, mes leçons de géographie se mélangeaient avec mes lectures d’îles au trésor, les pages se gonflaient et j’embarquais à bord de mon livre pour pêcher la baleine et la morue, au large des côtes d’Islande ou de Terre-
Puis les forêts reprirent le dessus, bientôt cachées à leur tour par le sol des villes et leurs arbres estropiés, et j’oubliai complètement l’homme de pierre, jusqu’à cet été qui s’était laissé assiégé par les eaux du ciel, à Quiberon, où mon fils devant la mer, me fit promettre de lui écrire des poèmes qui parleraient de nos vacances.
À cause de cette promesse dont je ne pouvais me défaire, j’ai commencé à arpenter la côte, en regardant longuement les vagues se succéder les unes aux autres, entrant dans les marées par la pensée, me changeant en algue, me blottissant dans les rochers pour écouter pendant de lentes minutes le martèlement des eaux, le bruissement du sable, le frémissement des bulles d’air qui se pulvérisaient dans les pores de la roche sous les gifles exsangues de l’océan, jusqu’à ce que peu à peu, la côte change de visage, le rocher se mette à parler et la mer, au langage jusqu’alors incompréhensible, fourmille de mots, de paroles révélées que je recueillais sous la dictée des éléments eux-
Dans ce dialogue aux voix multiples, je reconnus bientôt le timbre étrange de ce vieux compagnon de mon enfance, l’homme de pierre, qui s’était installé là, espérant mon passage, et que j’avais retrouvé.