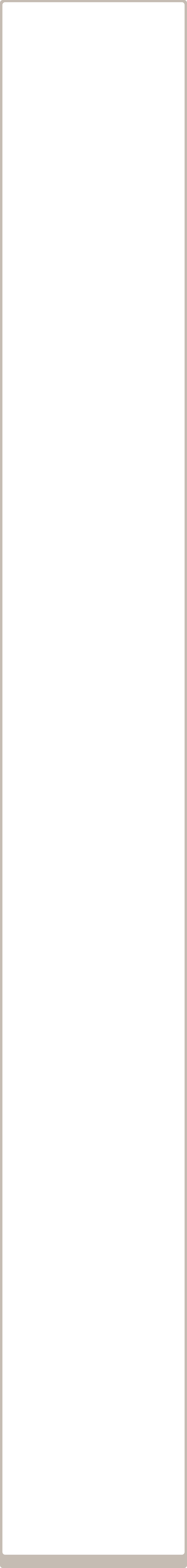
Copyright © 2010 Site officiel de Jacques Cassabois. Tous droits réservés
Site créé par Judith DELVINCOURT et administré par Martine POGNANT
Maj le 13/10/2022

Conférence donnée à la FNAC de Strasbourg
Le 24 février 2001
Il y a près de cinq mille ans vivait un homme, un grand roi majestueux et terrible dont le nom et les exploits causèrent à ses contemporains une impression si profonde que, dès après sa mort, ils se saisirent de lui et colportèrent son nom dans des légendes qui les aidèrent à batailler contre le poids du monde, la force de l’univers, avec les armes légères de la mémoire et l’ineffable de leur vie.
Gilgamesh ! Son nom campe à jamais sur cette lisière où les balbutiements de notre histoire sont en germe dans la terre grossière de la création. Qui sait si nous n’avons pas vécu à ses côtés, fils d’une civilisation qui émergeait tout juste de la nuit, écrivant sur l’argile les premiers rêves éveillés de l’humanité, luttant contre l’oubli, contre la mort, offrant au temps, pour les siècles futurs, à nos mémoires ranimées par les printemps de la vie qui nous feraient renaître, les réponses laborieuses, farouches, que nos cœurs inventaient lorsque nous levions la tête sur l’océan céleste tout fourmillant de feux.
C’est ainsi que tu demeures, Gilgamesh, grand frère, défricheur d’un chemin que nous avons tous emprunté  dans ton sillage, posant nos pieds dans l’empreinte profonde de tes pas. Tes efforts n’ont pas été vains. Tu es rentré, vaincu, mais tête haute du pays d’Outa-
dans ton sillage, posant nos pieds dans l’empreinte profonde de tes pas. Tes efforts n’ont pas été vains. Tu es rentré, vaincu, mais tête haute du pays d’Outa-
Et puis, tu as posé les armes. Tu as quitté l’argile qui t’avait enfanté pour la poussière du temps, mais la profondeur de ton regard est resté, la force de tes silences, la paix de ton visage qui savait nous redonner le sens de notre quête.
Gilgamesh, grâce à toi nous avons grandi, inventé des civilisations, croyant accroître encore le territoire que tu avais ouvert. Pourtant, hélas, nous avons peu à peu perdu ton ampleur. Nous avons oublié que la profondeur de tes yeux reflétait la paix de ton cœur et que la paix de ton cœur puisait en chaque instant, sa force et sa vigueur. Frêle cristal de l’instant… Nous l’avons tant alourdi d’espérances que le fil d’argent qui nous reliait à lui s’est rompu. Nous avons tant clamé sur son chant notre impatience de l’instant à venir qu’il s’est tu.
C’est ainsi que nous t’avons perdu, Gilgamesh. Et à mesure que nous nous écartions de ton chemin, il devenait plus urgent de l’accomplir à nouveau, pour notre propre compte.
Savais-
Résumé de l’Epopée
Avant d’entrer dans le détail de ma rencontre avec l’Epopée, je me dois, pour ceux qui ne la connaissent pas, d’en donner quelques traits qui la résument.
L’Epopée raconte l’évolution d’un homme, Gilgamesh, qui règne sans partage sur sa ville, Uruk, dans le sud de la Mésopotamie. Un homme puissant, intempérant, terreur des villes voisines contre qui il guerroie sans cesse et terreur de son propre peuple qu’il tyrannise au point que, lassé de ses exactions, celui-
Les dieux finissent par répondre et, pour le modérer, vont lui créer un double. Un être rudimentaire, à peine façonné, qu’ils installent dans la steppe, parmi les gazelles : Enkidou.
Gilgamesh, par un songe, est aussitôt informé du projet des Dieux et prépare sa contre-
Observons au passage que la civilisation, parce qu’elle est inculquée par une prêtresse, s’affirme d’emblée comme sacrée. Et que d’autre part, elle s’illustre dans trois principes fondateurs qui seront repris quelques millénaires plus tard par le Christ qui apportait un message d’amour et indiquait que l’homme pouvait s’unir au divin, en communiant à lui sous les espèces du pain et du vin.
Mais la rencontre avec Enkidou va déjouer toutes les prévisions de Gilgamesh
Pour la première fois, Gilgamesh ne va pas sortir vainqueur d’un combat et Enkidou, qui refusera de profiter de sa suprématie, laissera, au grand désespoir du peuple d’Uruk, le pouvoir au roi.
C’est ainsi qu’un piège redoutable va se refermer sur Gilgamesh, celui de l’amitié qu’il va éprouver pour Enkidou.
C’est cette amitié qui décidera Gilgamesh à partir conquérir la forêt des Cèdres pour distraire Enkidou qui se désole de sa vie citadine. Et cette conquête engagera les deux hommes dans des débordements qui obligeront les dieux à intervenir pour les secouer durement, donc les faire évoluer. D’où la mort d’Enkidou, et à travers la disparition de son ami, la prise de conscience par Gilgamesh, de sa propre mortalité. De l’horreur qu’il en éprouve découlera sa décision de partir au bout du monde, rencontrer le survivant du Déluge, Outa-
Premiers pas en Mésopotamie
J’ai récrit l’Epopée de Gilgamesh pour répondre à des questions qu’elle me posait, pour élucider le mystère de ses symboles, parce que j’avais espoir, à son contact, de construire un ensemble où je ferais sentir la force de la nature, la puissance des éléments, l’illumination qu’apporte la mort, le ferment qu’elle constitue pour la vie, la magie de l’homme au cœur de l’univers ; un ensemble qui emprunte à l’Epopée son souffle, nous restitue sa folle énergie primitive, qui demeure absolument ancrée dans sa terre d’origine, mais qui nous parle. Pour cela, il fallait que les personnages d’Enkidou et de Gilgamesh nous saisissent, et pour nous saisir, il fallait qu’ils nous ressemblent en partie, en partie seulement, afin qu’un décalage subsiste entre eux et nous, un vide que l’on puisse combler par une curiosité qui nous incite à les comprendre et à construire ainsi notre rencontre avec eux pour mieux découvrir en quoi leur aventure, malgré la distance, demeure féconde.
Ils ont frayé les premiers chemins de l’homme face à son devenir, apporté les premières réponses, forgé les premiers comportements devant la mort avec une autorité définitive. Je voulais que l’on mesure leur courage de novateurs, que l’on s’approprie leur exemple pour le méditer, à la lumière de notre vie présente...
Cela dit, me remémorant mon cheminement, je me rends compte que j’élude mes toutes premières réactions pour sauter à l’étape suivante. J’évoque une intention. Mais un autre état précédait l’intention : le frisson ! L’espoir d’une création, en effet, n’est jamais donné d’emblée et toute intention est déjà la synthèse d’un matériau brut, fait de vagues sensations, de questions non encore formulées, d’étonnements, d’indices à peine relevés, d’incompréhension touffue, le tout enveloppé d’un sentiment majeur de fascination. Le frisson ! La certitude qu’un miroir tente de nous attirer, qu’une voix cherche à se faire entendre, qu’un être subtil a flairé la présence d’un frère, un être qui espère, et qui vagit pour retenir celui qui passe à sa portée, pour le capter et l’envelopper enfin de son vieux souffle millénaire !...
Oui, au commencement, c’est bien par le frisson que l’Epopée s’est imposée à moi, car mes sens étaient plus aptes que mon esprit d’analyse à recueillir ces signes immatériels de sa présence.
Existait-
Gilgamesh et Enkidou
Le temps de l’écriture commençait. J’allais pouvoir me consacrer à Gilgamesh et Enkidou ; les découvrir à mesure que je les construisais et les construire à l’image de ma découverte.
Des deux, c’est Enkidou qui m’attirait le plus. Son tempérament rustique, sa familiarité avec les gazelles, son intimité avec les éléments, sa grande force primitive, sa candeur paisible, sa rugosité, puis sa docilité d’animal fidèle à l’égard de Gilgamesh et ses efforts douloureux sur le chemin de l’évolution, me le rendaient beaucoup plus sympathique que Gilgamesh, moins intéressant dans la première partie du récit au cours de laquelle, il mène un jeu qu’Enkidou subit. Ce n’est qu’après la mort de son ami qu’il devient pathétique, lorsque la souffrance endurée au cours de sa quête l’humanise peu à peu.
Cependant, écrire implique de choisir. Et certains choix fondamentaux s’imposaient. J’hésitais sur la manière de traiter concrètement Enkidou : sauvage intégral ou représentant d’une tribu rurale peu évoluée ? Mon envie de le servir au mieux rendait mon choix plus difficile et l’Epopée ne m’aidait guère. Lorsqu’elle le présente, elle insiste sur son côté sauvage, sommaire, mal dégrossi, incomplètement humain, mais plus loin, au moment de sa mort, elle évoque ses amis ; ce qui peut paraître contradictoire. En outre, à deux reprises, à l’entrée d’Enkidou dans Ourouk, lorsqu’il rencontre Gilgamesh en plein exercice de son « droit de cuissage », et lorsqu’il va mourir, le traducteur, Jean Bottéro, en deux notes, suppose qu’Enkidou devait appartenir à une de ces tribus peu civilisées qui vivaient à la frange du désert, et que les mœurs citadines choquaient ! J’avais un faible pour le sauvage. D’une part, parce que je n’avais pas à lui construire une vie sociale au sein d’une tribu avec famille et amis qui alimenteraient ses souvenirs et d’autre part, parce que sauvage total, son chemin jusqu’à l’homme devenait plus âpre et plus significatif.
En outre, son côté Tarzan me plaisait. Un Tarzan débarrassé de la puérilité hollywoodienne, qui évoluait lentement et qui gardait des traces de son passé obscur.
Gilgamesh, lui, me paraissait moins nuancé. Chef de bande, comme Enkidou est chef de harde, sa position de roi incontesté, en fait un individu achevé, monolithique, si peu enclin à évoluer qu’il faudra une force brutale pour briser sa carapace et faire apparaître l’humain. C’est une sorte de casseur qui détient le pouvoir, un fou dangereux, adepte de la violence, de la gloire par les armes, de sa suprématie sur les autres villes, de sa notoriété. Il n’a ni parole, ni scrupule. C’est une plaie, pour les peuples voisins, comme pour son peuple. C’est une brute. Il ne supporte aucune contradiction et c’est pourquoi, lorsqu’il va apprendre l’arrivée d’un rival sa première réaction sera de le neutraliser. Mais le rival n’est pas un être humain ordinaire et Gilgamesh ne se doute pas qu’il va contribuer à ébranler son propre système. Lorsqu’il s’en rend compte, il est trop tard. L’amitié est déjà installée et il est enserré dans un faisceau de sentiments subtils qu’il ne maîtrise pas. Le manipulateur, a son insu, est devenu manipulé.
En revanche, l’atmosphère de la Mésopotamie m’était familière. J’y retrouvais une vie campagnarde, une civilisation d’agriculteurs à laquelle je n’avais aucune difficulté d’accès. Je n’avais pas à beaucoup chercher pour trouver Sumer en moi. C’était le village de mon enfance, dans le Jura. Comme tous les paysans, les habitants d’Ourouk étaient des gens concrets. Ils entretenaient avec la terre, la nature, les éléments, des relations d’intimité. Ils leur parlaient comme j’ai entendu les paysans parler à leurs animaux, à leurs champs, aux nuages, au vent. Leur monde était peuplé d’une foule de présences animées au sein desquelles ils évoluaient avec familiarité. Pour suggérer cette vie, j’avais juste besoin de détails concrets spécifiques de la Mésopotamie, car l’essentiel de leur rapport à la terre, je le possédais.
Epopée et Crédibilité
Cependant, d’autres choix m’attendaient. Le choix du mode de narration, par exemple, la compréhension des symboles, la fidélité au contexte historique avec lequel il est nécessaire de prendre certaines distances, parce que les personnages, comme tous les hommes qui sont devenus symboliques échappent à leur époque pour devenir universels. J’espérais bien parvenir à élucider quelques uns des mystères de l’œuvre pour dégager une cohérence et atteindre une sorte d’enseignement général que je voyais encore mal. Je sentais quelque chose à mettre à plat du côté des relations de Gilgamesh avec la mort, mais j’ignorais quoi. Cette histoire d’acceptation finale m’embarrassait. Souvent présentée comme la preuve d’une résignation nécessaire de l’homme devant l’inéluctable, je ne parvenais pas à juxtaposer à cette résignation l’idée de défaite. Pour moi, Gilgamesh, après une telle descente au fond de lui-
Lorsque j’en discutais avec l’éditrice qui, à l’origine, m’avait commandé ce travail, elle disait des choses comme : « C’est lorsqu’il accepte d’être pleinement un homme qu’il se hisse au niveau des dieux. » C’était justement ce genre de phrases que je ne voulais pas écrire. J’avais l’impression qu’elles m’orientaient, mais j’avais beau les suivre, elles ne me conduisaient nulle part. Trop concises, pas assez vivantes, je n’y trouvais pas l’amorce d’un chemin pour développer la métamorphose.
En ce qui concerne les choix narratifs, le ton épique me préoccupait. C’était une des contraintes à respecter absolument. Ce ton, en effet, donne de l’ampleur, de la force, de la majesté au récit. C’est lui qui transforme les personnages en géants et ce gigantisme est indispensable, car c’est lui qui hisse Gilgamesh et Enkidou au rang de représentants des hommes. Certes, ils agissent pour leur propre compte, mais leurs actes sont portés par un tel souffle qu’ils les débordent et l’on voit bien que si Gilgamesh avait réussi à décrocher l’immortalité, c’est tout le genre humain à sa suite qui en aurait bénéficié. Le ton épique est donc à la hauteur de la quête. A l’inverse, avec lui, se pose le problème du réalisme.
Si les personnages ne nous ressemblent pas assez, on s’en désintéresse. Nos attentes narratives, aujourd’hui, ont une autre exigence. On veut connaître les personnages, suivre leurs actes, leur cheminement pour mieux les comprendre. Dans le texte initial, ils sont sommairement campés et ressemblent à des silhouettes, comme dessinées à plat sur un socle d’argile. Ils manquent de relief. Ils ont besoin des nuances de la profondeur, des clairs-
Certes, l’Epopée de Gilgamesh est parfaitement lisible dans son texte initial, que ce soit dans la version établie par Abed Azrié ou dans la traduction de M. Bottéro, la plus récente et la plus achevée. Mais sa lecture en demeure âpre, interrompue par des incompréhensions suscitées par des références à des pratiques inconnues, à une culture éloignée de la nôtre, mise à mal par les lacunes nombreuses qui hachent le récit. Parfois son mode incantatoire répétitif lasse ou prête à sourire.
De ce point de vue, l’Epopée demande à être abordée avec patience, écoutée en silence, en mobilisant toute son attention, comme on écouterait une vieille voix vénérable, venue du fond du temps, au langage oublié, au timbre fatigué et fredonnant une mélopée qu’on ne peut plus chanter parce qu’on a perdu l’usage de ses rythmes, de ses sonorités, au point que notre appareil phonatoire lui-
Si on est prêt à excuser ces aspects qui sont la marque de l’originalité, ils deviennent insupportables dans l’hypothèse d’une réécriture contemporaine. Cela dit, j’observe que, même paré des vertus de l’authenticité antique, le ton épique prête à sourire. Ce sourire, au mieux est un sourire d’attendrissement et l’attendrissement, ici, devient le pire des sentiments humains : la marque d’une supériorité. C’est toujours le grand qui s’attendrit sur le petit ; le puissant sur les efforts touchants d’inefficacité du faible ; le civilisé sur l’ignorance naïve du primitif ! On n’a jamais vu l’attendrissement remonter du bas vers le haut ! Ainsi, le moindre sourire à l’égard de l’Epopée devient inacceptable car il atténue sa force, diminue sa portée. Sous le sourire de l’homme contemporain, l’Epopée est soudain rabaissée au rang de lubie puérile inventée par des sauvages crédules !
Je ne supportais pas l’idée que les lecteurs de mon roman, si j’en avais un jour, pussent céder, par ma faute, à cette attitude méprisante. Il me fallait donc recourir à un moyen de concilier épopée et réalisme, gigantisme et crédibilité, afin d’introduire dans cette histoire l’équivalent de ce que l’on y trouvait à l’époque de Babylone et de Ninive. C’était à ce prix que l’on pourrait entendre chanter cette œuvre sans prêter l’oreille, l’entendre respirer de son souffle humain et respirer avec elle le même bonheur d’être vivant.
Ce moyen m’apparut d’évidence. C’était le langage. Le plus délicat restait sa mise en œuvre…
Symboles
Lorsqu’on lit les textes anciens, fondateurs de nos civilisations, on traverse une forêt de symboles et de mystères qui frémissent à chacun de nos pas. C’est comme déambuler dans une très ancienne demeure. Notre présence réveille une vie éteinte. Mais il y a toujours, au cours de ces visites, des corridors qui demeurent sourds, des salles qui restent obstinément verrouillées et l’on sent, à leur mutisme, que ce n’est pas notre sagacité qui percera le secret de la bâtisse, mais la bâtisse elle-
Je restais très influencé par Sindbad que j’avais réécrit peu avant et j’ai longtemps cherché dans l’Epopée, une structure sous-
Ainsi, du combat contre le Taureau Céleste qui ne pouvait pas être raconté comme la traversée du défilé des Monts-
Dans les combats, c’est la force qui prime. L’expression de la puissance physique la plus crue. C’est à travers elle que le sens devait s’élaborer. Dans l’épisode du Taureau, je ne me suis pas attardé sur la dimension symbolique de l’animal, qui renvoie à la lune par la forme de ses cornes, mais j’ai préféré jouer au premier degré en travaillant l’aspect bestial, sanguin, viscéral de cette lutte tellement abjecte que les Dieux interviendront en châtiant les responsables.
Le combat avec Houmbaba, le gardien de la forêt des Cèdres, est différent. Moins primaire, il se joue surtout entre Gilgamesh et Houmbaba. Tous deux sont de même rang, intermédiaire entre les hommes et les dieux. Ce sont des héros, au sens grec du terme. En outre, Houmbaba est très clairement un initié. Il possède une force que Gilgamesh ne possède pas : les sept terreurs, ou les sept fulgurances comme les appelle la version ancienne, ou encore les sept manteaux enchantés comme dit la version ninivite. Cet attribut renvoie immanquablement à une signification spirituelle. Les fulgurances sont décrites comme des roues flamboyantes qui tournent. Elles rappellent les sept chakras. Quant aux sept manteaux enchantés on ne peut s’empêcher d’y voir une métaphore du corps physique entouré de ses six corps subtils.
Que ce soit par les sept fulgurances de ses chakras dont il possède la maîtrise et qui le relient à l’univers d’où il tire sa puissance, que ce soit par les manteaux enchantés de ses corps subtils qu’il peut utiliser avec toute l’aisance d’un initié, Houmbaba apparaît comme hors d’atteinte de n’importe quel humain. D’ailleurs, Gilgamesh n’en vient à bout que grâce à l’aide d’un partenaire qui n’est pas Enkidou, mais Shamash, son dieu tutélaire, qui lui donne une arme de même calibre que celle de son adversaire, céleste et divine : les Treize Vents. Et l’Epopée précise bien que c’est lorsque les Treize Vents entrent en jeu, que la lutte bascule et tourne à l’avantage des assaillants.
Autre exemple :
La traversée du défilé des Monts-
Le texte original ne révèle rien de ce qui arrive à Gilgamesh dans le défilé. Il se borne à dire ceci : « Au bout de dix kilomètres, profonde était l’obscurité, sans la moindre lumière. Il ne pouvait rien voir, devant lui, ni derrière... » et se répète, sans variante, de dix en dix, jusqu'à la sortie au cent-
D’abord, l’entrée du défilé est gardée par deux Hommes-
Ensuite, l’obscurité qui règne entre les parois est annoncée comme redoutable. Sans doute parce qu’elle place l’individu face à lui-
Enfin, le défilé débouche sur le Jardin des Arbres-
Ainsi, après avoir repris à son compte le pire de lui-
Cette traversée des Monts-
Dans l’entrevue avec Outa-
D’abord sa structure intérieure. C’est un Dieu, Ea, qui donne les dimensions. Elle devait comporter 7 étages et chaque étage être formé de 9 compartiments. Autre point mystérieux, le volume de bitume utilisé. 10800 litres au total dont 3600 devaient servir à calfater les joints de l’Arche et 7200 être emportés en réserve.
Si l’on convertit les litres en hectolitres, on obtient les nombres 108, 36 et 72. La signification de ces nombres cadre parfaitement avec le projet de l’Arche ! 36, en effet, représente le Ciel, 72, la Terre et 108, l’Homme !
C’est 36 qui recouvre les parois de l’Arche, qui la rend étanche, qui l’empêche de sombrer. Elle se trouve donc sous la protection de l’Esprit qui veille au bon déroulement du processus en cours, à l’intérieur. Quant à 72, la Terre, c’est bien elle qui est embarquée avec toute sa production d’animaux, d’hommes et la quintessence de la civilisation à travers les techniques qui font partie du voyage (les techniques ne figurent pas dans la narration biblique). Et 108, l’Homme. Pas n’importe lequel. L’ Homme nouveau issu du mariage du Ciel et de la Terre. Celui qui servira de prototype à une nouvelle humanité, selon le projet d’Ea.
La structure de l’Arche me parut plus énigmatique. 7 étages et 9 cellules. 7 évidemment symbolise la création du monde ; ce qui confirme qu’il est bien question d’une création sacrée dans cette Arche. Par ailleurs, 9 évoque les gestations.
Leur produit donne 63. Un nombre qui ne revêt aucun caractère symbolique, alors que soixante-
C’est en me posant la question à haute voix que la réponse m’est venue. C’était Outa-
La grande victoire de Gilgamesh
Après son périple au bout de la terre, Gilgamesh revient les mains vides de ce qu’il espérait rapporter : l’immortalité. Vides du peu qu’Outa-
Accepter ! L’acceptation est le premier mouvement d’un processus qui fait de la prise en compte de la réalité, une source d’évolution. Accepter l’instant qui passe. Le considérer comme un maître qui nous apporte toujours la réponse à la question que la vie nous pose. Mais pour tirer parti de tout ce que l’instant charrie pour nous, il faut commencer par l’accueillir. Sans protestation, dire oui, pour mieux l’entendre, mieux le comprendre. La plupart du temps, particulièrement lorsque la réalité nous est défavorable, nous la refusons, nous nous rebellons contre elle, en criant à l’injustice, et nos envies d’action (en fait des réactions), s’édifient sur un socle bancal constitué par nos refus.
Notre société, notre histoire ont toujours placé les valeurs d’opposition au-
Gilgamesh, par son échec, nous rappelle les limites de l’action fondée sur le refus. C’est la boulimie du goinfre et la surenchère de la revendication quantitative. A l’inverse, en acceptant d’être un homme, en ne reniant plus sa mort future, en accueillant la quintessence subtile de chaque instant, il retrouve la force de l’innocence. Il devient un gourmet de vie, friand de qualité. Et sa défaite devient victoire !
Après sa confrontation avec Outa-
C’est ainsi que Gilgamesh, par la force de sa tentative personnelle à l’égard de la mort, par la représentativité de son acte, nous place nous aussi individuellement devant la mort et nous restitue une responsabilité longtemps confisquée par les idéologies matérialistes ou religieuses. Grâce à lui, la mort redevient une aventure personnelle, une des clés du mystère de la vie. Il nous encourage à l’habiter totalement sans nous en laisser déposséder lorsque l’instant viendra et, en l’attendant, à puiser dans la moindre miette de vie les aliments d’un festin qui enrichira le moment du passage.

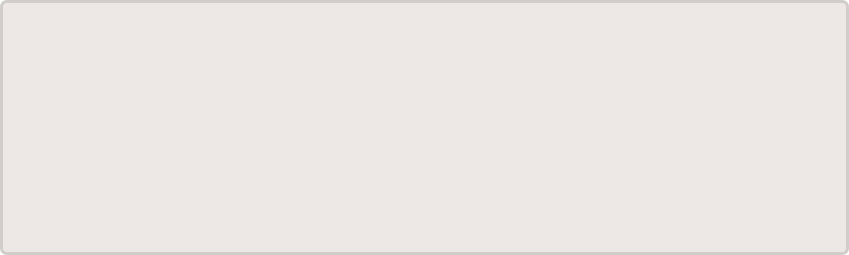

Ce bandeau est un montage de plusieurs céramiques du sculpteur Australien, Neil Dalrymple.