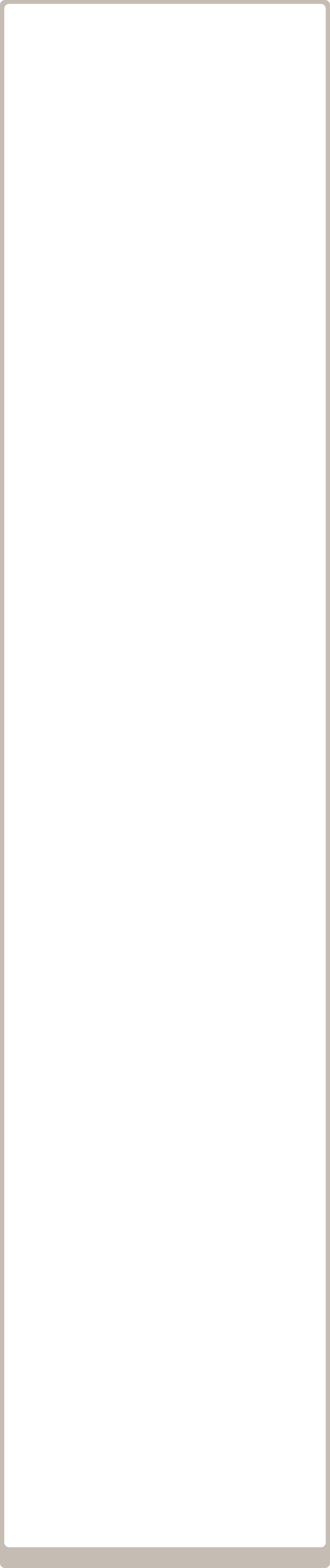
Copyright © 2010 Site officiel de Jacques Cassabois. Tous droits réservés
Site créé par Judith DELVINCOURT et administré par Martine POGNANT
Maj le 06/12/2023

Page 1 sur 5
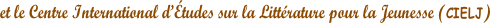

Jacques Cassabois est né en 1947 dans le Jura. Après avoir suivi les cours de l'école du Théâtre National de Strasbourg, il devient instituteur, puis animateur à la Fédération des Œuvres Laïques de Seine-
Sans plus attendre, accueillons Jacques Cassabois, auteur opiniâtre et exigeant, et… « fourmi » dans l’âme.

« Je ne suis pas un héros ! » chantait Daniel Balavoine. Je pourrais le chanter aussi. Ce m’est donc un peu compliqué d’en trouver un auquel m’identifier. Et puis vous savez, le héros est un concept grec qui renvoie à la notion de demi-

Le problème avec les utopies, c’est qu’elles sont tôt ou tard confisquées par les idéologies et qu’on se réveille toujours un matin avec la gueule de bois, croyant avoir œuvré sincèrement à la propagation d’une idée, en n’ayant rien fait d’autre qu’assurer le pouvoir et les privilèges de ceux qui s’en sont institués les garants.
Tout bien considéré, les seules utopies recevables sont les utopies personnelles, intérieures, qui n’exigent rien d’autre que nos propres efforts pour se réaliser. L’utopie proposée par les mystères d’Éleusis reste toujours sur le chantier : l’homme comme clé de compréhension de l’univers et son corollaire, pour changer le monde, changeons le cœur de l’homme. Comme chacun porte une part de responsabilité, nous avons tous largement de quoi nous occuper durablement et à peu de frais. Nul besoin d’appareils ni d’apparatchiks. Nul besoin non plus de ces conférences internationales qui vous claquent en quelques jours de quoi nourrir tous les faméliques de la planète.

Je devais vraiment être auteur de livres pour la jeunesse. Cela n’a jamais été un rêve, mais une réalité qui s’est imposée à moi, au fil du temps et dont j’ai vraiment pris conscience il y a quelques années. J’ai d’ailleurs écrit un livre qui décrit, à travers trente ans d’engagement, comment ce processus est entré dans les faits. Ce livre s’intitule L’ART DE L’ENFANCE. Faute d’avoir pu y intéresser un éditeur, il se trouve intégralement sur mon site internet
Je ne rêve pas d’être quelqu’un d’autre. Ce rêve-

J’écris dans mon bureau. J’y entre tous les matins autour de quatre heures, régulièrement. La régularité m’est nécessaire et elle favorise ma concentration. Je suis un lent. J’ai besoin de travailler beaucoup et tous les jours.
L’inspiration, cet instant privilégié de clairvoyance où, en une fraction de seconde, ce qui vous tenait en échec la veille vous apparaît soudain, illuminé, à votre portée, survient rarement dans mon bureau mais dans mon lit, dans l’instant de clarté qui suit le sommeil de la nuit, ou pendant les insomnies. Ce sont des instants denses et fugaces. Le moindre geste les disperse. Mon impatience à les retenir les a souvent gaspillés et je me suis organisé pour ne plus les perdre. J’ai toujours de quoi écrire sur ma table de nuit. Quand ils surviennent, je note à tâtons, sans allumer la lampe (pour ne pas réveiller ma femme) et en fermant les yeux (pour ne pas me réveiller), quelques mots clé qui me permettent, une fois levé, de reconstituer les détails de ma vision. Ensuite, savoir si ce que j’en tire s’intégrera dans mon récit en cours, c’est une autre question.

Le sentiment que je n’ai pas encore vraiment commencé.
Un jour que je discutais avec Claude Duneton, il me confia qu’après avoir écrit son livre RIRE D’HOMME ENTRE DEUX PLUIES, il s’était senti en paix. « J’avais l’impression, ajouta-
Je comprenais très bien, mais je n’ai jamais éprouvé une telle impression. J’espère toujours y parvenir.

D’être séparé de ma mère.

Bien-

Dégage de ma route, gros lard !

Un double exigeant, qui m’incite à le suivre, à remettre sur le métier quand j’écris. Je l’ai rencontré de loin en loin, au cours de ma vie. La première fois vers quatre ans. J’ai fini par le cerner en écrivant L’ART DE L’ENFANCE où je lui consacre un chapitre. Je l’appelle L’ENFANT ABSOLU.

Vendre ? Qu’entend-
La vente est aussi une question de positionnement commercial, de stratégie marketing. Elle fait l’objet de décisions. Je ne vais pas en parler, ce n’est pas mon métier. Je vais m’en tenir à la part de l’auteur.
Pour vendre, il faut plaire aux lecteurs n’est-
Oui, ça doit aider ! Sauf qu’on a parfois envie de tirer la langue à ces critères et sauf que tous les livres qui les respectent ne se vendent pas de la même manière. Donc, ces paramètres n’expliquent pas tout. Pourquoi un livre sort-
La première parce qu’il y a une sorte d’équilibre qui s’établit entre d’une part une demande ou plutôt une attente (certains éditeurs ont un nez pour la capter) et une offre qui vient au moment opportun la satisfaire. Une synchronicité parfaite (qui n’est pas forcément instantanée. Certains livres peuvent mettre des mois, voire des années à s’imposer), dont les lois restent à découvrir.
La seconde, parce que l’auteur du livre mérite ce qui lui arrive.
Cela dit, le désir d’écrire d’un auteur est complexe et je ne suis pas certain que les perspectives de vente y tiennent une si grande place, en tout cas chez ceux que je connais, même si aucun d’entre eux ne fait la grimace quand un de ses livres réussit.
Personnellement, ce n’est pas l’espoir de décrocher un hypothétique jack pot qui m’anime quand je commence un nouveau livre, mais l’envie de relever un défi, de réussir enfin à écrire le livre qui me tient en échec depuis toujours, pour trouver l’apaisement de Claude qui éclatait dans son RIRE D’HOMME. Et j’ai vite fait d’oublier les fameux critères qui sont censés faire vendre. C’est une course qui s’engage entre L’enfant absolu et moi qui peine à le suivre. J’écris pour rester dans sa trace, pour ne pas me laisser distancer. L’écriture devient alors mon chemin de vie et le véhicule qui me permet d’avancer.
À la longue, j’ai fini par remarquer qu’elle m’offrait au quotidien, tant dans mon travail solitaire que dans la confrontation de ce travail avec les autres, une pluralité de situations parfaitement adaptées à la transformation personnelle dont je parlais plus haut et que je dois à accomplir.
Bien sûr, quand en plus mes livres se vendent, je gagne ma vie et je suis extrêmement satisfait.

Inclassable. Et comme vous dites, ça colle !

C’était un dimanche. Je signais des livres dans un petit village voisin du mien. Une fillette qui venait d’entrer  en sixième. Elle s’appelait Camille. Elle avait lu mon TRISTAN ET ISEUT quelques mois plus tôt, quand elle était encore au cm2. Qu’elle ait avalé les six cents pages du livre, je n’en revenais pas. Devant mon étonnement, elle me dit :
en sixième. Elle s’appelait Camille. Elle avait lu mon TRISTAN ET ISEUT quelques mois plus tôt, quand elle était encore au cm2. Qu’elle ait avalé les six cents pages du livre, je n’en revenais pas. Devant mon étonnement, elle me dit :
« J’ai mis une semaine. J’aurais pu mettre moins. Mais parfois (et là, elle plaça ses mains en coupe devant elle, comme on recueille l’eau d’une source pour se désaltérer), c’était tellement vibrant que je refermais le livre pour ne pas aller trop vite, mais je le rouvrais tout de même, parce que je voulais savoir la suite. »
Tellement vibrant ! En arrivant à la maison, j’ai aussitôt partagé cette rencontre avec ma femme. Le lendemain, je la racontais à mon éditrice.
Me revenait à l’esprit certaine note de lecture paresseuse qui m’avait blessé, d’une critique qui se demandait si cette « plus belle passion de tous les temps » allait beaucoup intéresser les ados, sur le petit air grinçant de « On sait bien ce que veulent les jeunes lecteurs. Obtempérez donc, messieurs les auteurs. Efforcez-
Merci Camille, tu m’as rassuré. Je ne t’oublierai jamais.
"Je ne cherche à les aider à grandir, à réfléchir, à les convertir à la pertinence, à la profondeur, que sais-
Extrait de l'Art de l'enfance, Chapitre 13 "Littérature pour", pp 20-

Les définitions ne sont pas trop mon truc. Je sais, ça fait toujours brillant et cultivé, d’en glisser une dans la conversation. Mais, désolé, je n’ai pas ça en magasin.
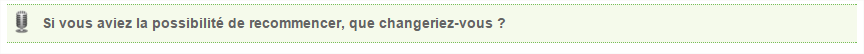
Pour l’instant, rien ! Mais je sais que je n’aurai pas épuisé ma cuirasse d’insuffisances humaines dans cette vie. Alors, sans doute, je devrai me remettre à la tâche. Sur quoi ? C’est un peu tôt pour le dire. Tout n’est pas joué. Il faut d’abord que j’en finisse, que je termine ce voyage au bout de la vie, au bout de la nuit. Mon dernier souffle peut encore tout transformer, puisque, dit-
Quand j’aurai rendu l’âme, comme un élève studieux sa copie, je pourrai faire le point dans la lumière crue de la vérité. Les examinateurs ne sont pas complaisants et je ferai partie du jury. Alors, une fois mon dernier ouvrage passé au crible, une fois le bilan dressé des pertes et des profits cumulés depuis ma première aube, j’endosserai à nouveau la tunique de peau du vieil Adam, nanti d’une nouvelle feuille de route, pour une nouvelle tentative et je renaîtrai, porté par le souffle des étoiles. C’est alors que j’aurai la possibilité de tout recommencer.
J’ai appris à lire tout seul à cinq ans, en écoutant déchiffrer les grands du CP, depuis mon banc de section enfantine, ce qui me laisse à penser que les mots écrits devaient me paraître familiers pour m’attirer ainsi.
Mais je n’étais pas vraiment un « genre » de lecteur. Nous n’avions pas assez de livres pour cela et je lisais ce qui se présentait. Un ami de mes parents m’avait abonné au journal Bayard. Il sortait le jeudi (jour de congé, naguère). À côté de ce journal, mes lectures avaient deux sources principales d’approvisionnement. Le maître d’école, qui nous prêtait épisodiquement des livres de bibliothèque, le samedi après-

La mauvaise foi. Et plus les années passent, plus elle s’accumule, je trouve, et plus j’ai du mal.

La fourmi. Pas la reine de la colonie, évidemment, ni un soldat. Une ouvrière. Parce qu’elle est petite, opiniâtre, qu’elle travaille beaucoup et que son ouvrage, pour infinitésimal qu’il soit, contribue à la cohésion de la collectivité.
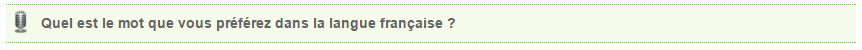
Le mot bienveillance. Je l’ai rencontré incarné, une fois dans ma vie. Il s’appelait Jean Bottéro.

« Quel acte avons-
Cette phrase est la dernière de mon recueil DIX CONTES DE FANTÔMES. A trop considérer l’avenir, on risque de ne pas voir la pierre devant nos pieds, qui va nous faire tomber.
