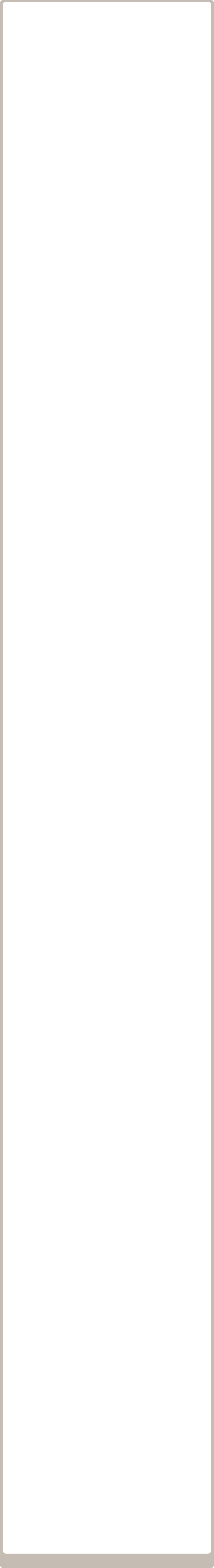
Copyright © 2010 Site officiel de Jacques Cassabois. Tous droits réservés
Site créé par Judith DELVINCOURT et administré par Martine POGNANT
Maj le 13/10/2022
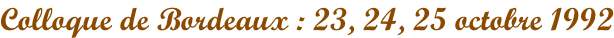
Chercher sa place en emportant son enfance
Mes livres, fréquemment, m'amènent comme beaucoup d'auteurs, à rencontrer des enfants. J'aime ces rencontres. Derrière chaque enfant se cache une enfance. Particulière et invisible. Dissimulée par la classe, le groupe, les rapports sociaux.
Il arrive parfois que le climat de la rencontre réchauffe ces enfances, les encourage à se découvrir. Alors, les questions des élèves qui interrogent, brièvement, se changent en réflexions d'individus qui pensent. Alors, les questionnaires préparés qui ont servi à faciliter la métamorphose disparaissent dans les cartables ou s'endorment sur les tables.
Quelque soit la qualité de notre conversation, je sais que de toute façon, à un moment ou à un autre, un enfant lèvera le doigt et, avec un parfait détachement, me demandera:
-
Et aussitôt, parce que je ferai la moue, un autre, comme on offre une seconde chance, ajoutera :
-
Je répondrai :
-
Je laisserai un silence. Je regarderai les enfants dans les yeux, comme on cherche un appui pour se hisser et je reprendrai :
-
-
J'éluderai et je continuerai.
-
Un énorme éclat de rire fera trébucher ma phrase et m'obligera à rire à mon tour. L'ami veille toujours. Je l'entendrai murmurer :
-
Je regarderai les enfants pour la seconde fois dans les yeux. Je les verrai attendre. Je verrai dans cette attente leur certitude que je sais répondre. Je soupirerai et je dirai :
-
Alors, je m'assois devant mes feuilles. J'essaie d'oublier la rue sur le devant de ma maison et le jardin, sur l'arrière, les merles et les pigeons. J'essaie d'oublier comme on se cache sous les couvertures, comme on se plaque les mains sur les oreilles. Je me protège des pensées de l'extérieur. Je m'installe en dedans.
Ici, je suis chez moi. Dans le tabernacle. J'y entre avec appréhension. Je n'y trouve ni la paix, ni le silence. C'est un lieu de vacarme et de hurlements, d'ordres et de contre-
Ici, les océans se plaisent dans les tempêtes, le vent ne souffle jamais sans arracher, les rivières charrient des noyés et, dans le sombre des forêts se fomentent des viols et des assassinats.
Il me faut rester longtemps, dans la lumière d'hiver de mes yeux clos, devant ce fatras. Et j'hésite, je cherche un passage. Et je retiens ma main. Je me souviens, je la retenais aussi devant mes rédactions de lycéen qui me laissaient paralysé des jours, à l'affût des idées. Je la retenais déjà sur mes cahiers d'écoliers, lorsque le maître veillait, je m'en souviens. Écrire alors, n'était pas seulement écrire.
-
Écrire ! Calibrer les lettres, ramper dans l'interligne, frôler les marges avec prudence, en prenant garde de ne pas empiéter. Écrire ! Délimiter sa place pour s'y tenir. Apprendre la bonne éducation des mots qui ne se trompent pas, ou proprement, sans ratures.
Malgré le temps passé, le maître est toujours là, dans sa blouse de brouillard, son porte-
Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours retenu ma main au-
Aussi loin que je me souvienne, c'était l'imminence d'un danger bien plus grave qui dépliait mon bras et me forçait à écrire. C'était la conséquence de la retenue: la crainte d'affronter ma mère, ses réprimandes, sa déception de me voir différent de ce qu'elle espérait.
Je finissais donc par écrire. Je cherchais des mots qui n'abiment pas le cahier, qui effleurent à peine le papier. Des mots éduqués qui chassaient tous les désordres. L'école de l'écriture ressemblait à l'école de ma mère, où il fallait toujours faire des efforts de propreté. Jouer sans se salir, rire sans s'énerver, courir sans s'échauffer, ne pas dire de gros mots pour ne pas faire pleurer Jésus qui avait déjà tant de mal avec les péchés des autres, sans avoir en plus à se charger des miens.
Ma vie était donc à ce point liée à ce que j'écrivais, pour que les vigiles du droit s'affolent ainsi lorsque je prenais mon porte-
Épouvanté par les conséquences, j'obéissais. J'écrivais des phrases légales.
Mais les veilleurs avaient beau veiller, un mot, ici ou là, parvenait toujours à m'atteindre, à chuchoter sans qu'on l'entende, à me glisser sans être vu, un message particulier. Mot rebelle, à la voix de source. Mes doigts fourmillaient longtemps de sa présence. Ce fourmillement remontait en caresse jusqu'à mon épaule et, de là, partait ensemencer les plaines de mon dos, de mon ventre. Je restais, les yeux éperdus, devant ces applaudissements de ma chair.
-
Rêve pas ! Le secret des mots se cachait-
-
Écrire, ce n'était plus écrire, calligraphier des lettres, contenir ses émotions pour éviter les taches, satisfaire les maîtres et réjouir maman. Écrire, c'était désobstruer les ruisseaux de la nuit, labourer en terre profonde, offrir du vent à mes voix silencieuses, ces voix que les grands ne semblaient plus entendre. Écrire, c'était affronter mon désordre, essayer de surnager en m'agrippant aux mots. Des images nouvelles surgissaient, surprenantes ou incompréhensibles, toutes légitimes, voluptueuses. Avec le temps, l'habitude de les fréquenter, j'y décèlerais des intentions, des directions et, sur la durée de ma vie, qui sait, peut-
Mais l'effet d'un seul mot ne suffit pas à convaincre. Il faut enfreindre et enfreindre encore. Se laisser entraîner par la délinquance du vocabulaire. Entrer dans le secret des journaux intimes, des poèmes d'adolescent. Hurler longtemps en silence son envie de proclamer, avant d'oser dire à voix haute, avant de découvrir que cette voix singulière qui murmure chez vous, murmure aussi chez d'autres.
Voilà ce que je répondrai quand on me demandera: " Pourquoi...?" Et je sais qu'alors, un doigt se lèvera pour insister :
-
Je regarderai la fille, le garçon qui a parlé. J'envierai la clarté de ses yeux francs. J'y puiserai l'énergie d'être simple. Je dirai :
-
Je me regardais. Du ventre au visage, en remontant, mes yeux chassaient une ombre qui glissait. Un nuage bas dont le gris courait sur moi. J'essayais de le surprendre. Je sortais du champ du miroir, j'y rentrais brusquement. Je parlais.
-
Mon reflet répétait: "Bonjour. Qui tu es ?" À contretemps. Je guettais l'instant où il se soudait à moi. Une infime impulsion, un amarrage très doux. J'en tirais la certitude qu'il était vivant, menait derrière mes gestes, une existence détachée.
A chacune de nos rencontres, je fêtais, à quelques pas de lui, ce rite des retrouvailles avant de m'approcher. Je plaçais mes paumes contre les siennes, très exactement contre et, ma bouche posée sur ses lèvres, je chuchotais :
-
Un sourire flottait dans ses yeux. Je le sentais s'éloigner, aspiré par une liberté qu'il ne pouvait m'offrir. J'essayais de le retenir.
-
Mon reflet se bornait à répéter mes questions, jouait au maître, refusait de lever les obstacles à ma place.
-
Je devinais derrière ses esquives une nuit fertile.
-
J'exagérais le mouvement de mes lèvres. J'essorais les syllabes.
-
Une présence opaque m'envahissait et j'écoutais, immobile, son battement lourd qui respirait comme une grande terre sans limites.
Mais une main de sable surgissait, brouillait toute cette densité et le miroir s'éteignait. Je me laissais glisser au sol, m'agenouillais sur un coussin, au seuil d'un monde insaisissable. Je sanglotais.
Cet enfant-
Il faut croire que l'écriture, que la fréquentation des enfants concentrent tous ces dangers puisque ce sont ces occasions précisément, qui le font sortir de sa réserve.
Je l'entends arriver au froissement de son sourire de soie. D'un geste facile, il déroule devant moi le serpentin des années, me rappelle des paroles prononcées jadis, des serments farouches, des chagrins, mes craintes, à force de ne pouvoir situer ma place, de n'en avoir aucune, l'impatience enfin, de devenir.
Et tout ce passé se bouscule en moi, dans la clarté du présent, attise les solidarités, reconstitue l'unité entre hier et aujourd'hui.
Ayant remémoré, mon gardien se retire, martin-
Je l'écoute quand il parle et je lui fais confiance. Il n'attend rien, ne réclame rien. Il se contente de témoigner et c'est pour cette raison que sa voix est juste.
Cet enfant-
Il faut sa présence pour mesurer le temps. C'est lui qui nous offre cette étrange photographie de nous, prise en pause, depuis notre naissance. C'est bien nous, ce long ruisseau lumineux, tout irisé de notre intimité, moiré de notre vie quotidienne, qui serpente en sinuant parmi d'autres ruisseaux, sur la terre de l'Histoire. Nos histoires personnelles enchevêtrées dans l'Histoire, accueillies par elle, nichées en elle, mais fécondes aussi. Elles y puisent et l'alimentent. Elles rongent et régurgitent. Elles participent à son parfum particulier d'époque, en rupture avec les époques antérieures.
Mais comment retrouver sa place lorsque le regard s'est élargi sur l'Histoire ? Lorsqu'il a perçu la multitude des destins ? Lorsqu'il a tressailli de la rumeur foisonnante du temps ? Comment s'établir dans sa place lorsqu'on est pénétré de sa fragilité ? De ses limites ? Comment la revendiquer sans verser dans la vanité ? L'aimer sans succomber au narcissisme ?
Il est tentant, devant ces périls, de la minimiser, de la renier. Il est facile d'abattre l'arbre, sous prétexte qu'il peut cacher la forêt.
Certains, devant ce risque, préfèrent revêtir le scaphandre étanche de l'historien et s'immerger dans le fleuve de l'Histoire en restant à l'abri de l'eau, sonder l'infiniment grand, dresser l'inventaire des humeurs, des craintes, des révoltes, des intuitions humaines ; classer, affirmer les parentés, révéler les continuités entre les siècles des siècles ; dire "l'Homme" ou "les Hommes", avec un mouvement du menton qui pousse le regard très loin, très haut, où ne parvient jamais le chant du grillon.
D'autres plongent dans l'actualité qui énumère, bouillonnent dans le fouillis des événements, s'identifient aux plus porteurs d'audience, donc de reconnaissance, sans s'attarder jamais sur la libellule qui vient de défroisser ses ailes en eux, sur son premier vol ébloui.
Pourtant, si vous ouvrez votre journal local, vos libellules et vos grillons sont là, dans la texture des choses, parmi les méfaits de la semaine, l'assemblée générale de la Maison pour Tous et les polémiques du conseil municipal de votre commune. Si vous ouvrez vos livres d'histoire, les libellules et les grillons de vos ancêtres sont là, silencieux, figés dans des chapitres qui ont perdu le son de leurs voix.
Malgré toutes les grilles d'analyse, toutes les visions diachroniques ou synchroniques, vous êtes là, enfoui mais vivant, parce que l'individu est toujours au commencement, parce que le singulier est le ferment de tous les pluriels, parce qu'à force de raisonner ou d'accorder du crédit aux grandes voix qui raisonnent sur notre évolution, la prévoient, expliquent nos changements en termes de tendances collectives, à grands traits, on perd la perception du détail, on craint sa singularité, on se conforme, on renonce à sa place.
Il y a quelques années, parce que je voulais savoir comment je m'étais enraciné dans la vie, j'ai sollicité la mémoire de personnes âgées de ma famille. J'y ai découvert le fil conducteur de ce qui allait devenir un roman : LES DEUX MAISONS.
J'ai écouté ces gens évoquer leur jeunesse. Le tourneur m'a présenté les essences de bois, m'a expliqué le fonctionnement des tours. Je l'ai regardé ressusciter pour moi les gestes, avec les gouges et les curettes. Le débardeur m'a fait comprendre le levage des bois, cric en main, m'a fait marcher dans la forêt à ses côtés, de son pas de vieil homme qui retrouvait l'ancienne lenteur des bœufs. La mère de famille m'a dit le blé et la farine, l'interminable sortie de l'hiver jurassien qui vidait les réserves, les négociations avec le meunier pour emprunter sur la récolte à venir. Tous ont évoqué leur jeunesse, l'importance du travail des enfants dans l'économie familiale.
Mais il ne suffisait pas de questionner et d'écouter attentivement. Il fallait évaluer l'échelle de ces préoccupations, mesurer la portée réelle des gestes en les mêlant à d'autres gestes, hiérarchiser les sentiments. Bref, il fallait poser la silhouette de l'individu sur l'horizon collectif. Il fallait comprendre. Comprendre !
J'ai cherché des éléments dans les livres d'histoire, appris l'entre-
Je me suis avancé au second plan. Je suis entré dans les journaux. L'actualité s'y décantait déjà, mitonnant les hors-
Mais il me restait encore à pénétrer profondément les cœurs.
Alors, j'ai puisé dans mes propres réserves. J'ai cherché des équivalences entre 1925 et 1955. J'ai apprivoisé longuement ce passé inconnu dans la chaleur de mon propre passé. Les heures silencieuses dans la tournerie de mon grand-
L'eau fertile de l'enfance faisait germer ces témoignages, tuméfiait le moindre indice, enrouait la voix magistrale de l'Histoire, se répandait partout, déposait ses limons, préparait une grande synthèse d'alluvions.
Tout le moelleux de la vie dormait dans cette eau-
Comment peut-
Nos enfances nous demeurent des bagages salubres. Continuer d'écouter des voix qui s'étonnent est utile aux certitudes. Continuer d'ouvrir des yeux qui se révoltent est tonique pour l'indifférence. Retrouver dans son âge d'homme, les mystères de la vie qui vous secouaient dans votre âge d'enfant, invite à la mesure.
Mais qu'il est difficile, lorsqu'on arbore les insignes de l'adulte, de résister au réflexe des hommes de la Renaissance à l'égard du Moyen Âge. Les éblouissements du pouvoir nous incitent si souvent à mépriser les années de conquête.
C'est pourtant le même ruisseau qui s'écoule, les mêmes galets qui en tapissent le lit, les mêmes tourbillons qui les polissent, de la source au confluent.
Voilà ce que je répondrais si on insistait au sujet des enfants.
Mais je sais que lorsque j'aurai dit, un autre enfant lèvera le doigt et balaiera mes réponses en reposant les mêmes questions, comme pour m'inviter à y revenir sans cesse par l'écriture.
Je regarderai cet enfant. Il est entré le dernier dans la salle, une fois tous les autres installés. Sous ses vêtements d'aujourd'hui, je le reconnaîtrai à ses yeux inchangés.
De page en page, de rencontre en rencontre, il est là, compagnon de mes premiers mystères, solidaire et j'ai si peur qu'un jour, il vienne à perdre ma trace.
Jacques Cassabois
LES AUTEURS
Azouz BEGAG, Chercheur au CNRS, écrivain
Jacques CASSABOIS, Instituteur, écrivain
Rolande CAUSSE, Ecrivain, professeur-
Pierre CLANCHE, Professeur en Sciences de l’Education
(Innovation pédagogique et politique locale), (Université de Bordeaux II)
Bernard COLAS, Documentaliste de lycée
Jacqueline DUHEME, Illustratrice et peintre
Denise ESCARPIT, Maïtre de conférences honoraire (Université Michel de Montaigne, Bordeaux III)
Pierre de GIVENCHY, Président de « Vivre et l’écrire »
Christian GRENIER, Professeur, écrivain, co-
Jacqueline HELD, Professeur de philosophie, écrivain
Thierry JONQUET, Ecrivain
Charles JULIET, Ecrivain
Ly Heng KUHN, Etudiant, écrivain
Philippe LEJEUNE, Professeur de littérature française (Université de Paris-
Yvon MAUFFRET, Ecrivain
Suzie MORGENSTERN, Maïtre-
Isabelle NIERES, Professeur de Littérature Générale et Comparée
(Université de Haute-
Jacques NOIRAY, Professeur de Littérature française (Université de Paris IV)
Jean PERROT, Professeur de Littérature Générale et Comparée (Université de Paris-
Christian POSLANIEC, Chargé de mission à l’INRP, responsable de PRO-
Bernadette POULOU, Professeur de Lettres
