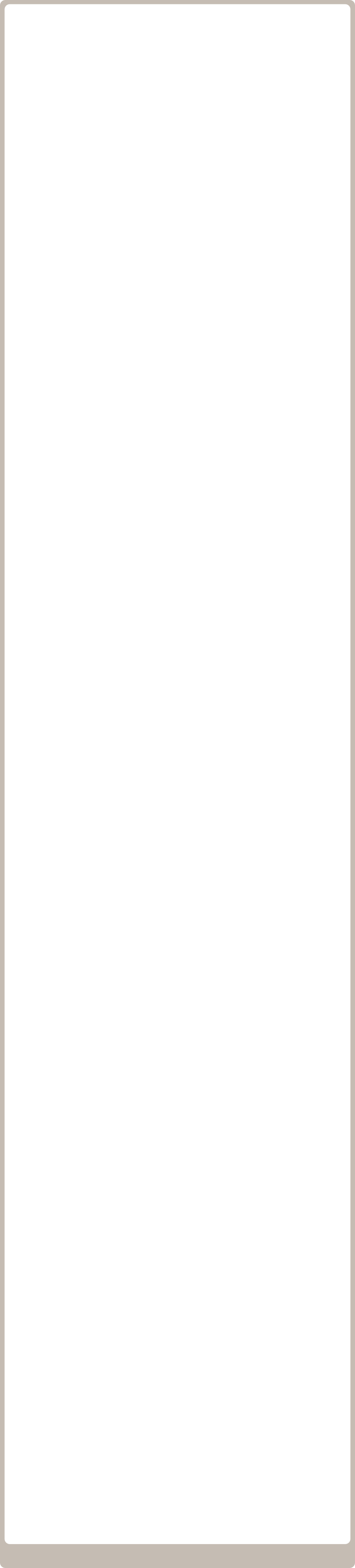
Copyright © 2010 Site officiel de Jacques Cassabois. Tous droits réservés
Site créé par Judith DELVINCOURT et administré par Martine POGNANT
Maj le 13/10/2022

« Un auteur ne nuit jamais tant à ses lecteurs que lorsqu’il dissimule une difficulté. »
Évariste Galois, Préface, décembre 1831
Récrire les textes des auteurs du passé. A-
Entre les chevaliers du Temple et les suppôts de l’absurdité, les offensives se multiplient. Aussi, n’ajouterai-
Mon apologie n’a rien de théorique. Elle est celle d’un artisan, nourrie par mon travail, soit plus de vingt livres qui m’ont fait éprouver ce que signifie récrire.
Récrire comme on distille, cherchant la sobriété de l’épure. Une démarche sans âge, sans genre, sans racialisme, sans insulte à la liberté et au respect, sans esprit de vengeance contre qui que ce soit.
C’est la mienne.
Cette expérience me permet d’affirmer ceci : entre les dénonciations pertinentes des docteurs, qui déplorent à raison la déliquescence de la culture classique et le harcèlement outrancier des militants sociétaux multicartes, raidis par l’amidon de leur terrorisme intellectuel, il y a la place pour une troisième voie, celle de l’honnête homme.
Récrire, e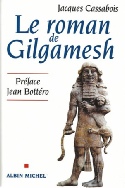 t non réécrire qui évoque trop l’anglais re-
t non réécrire qui évoque trop l’anglais re-
L’auteur qui récrit un texte que les siècles nous ont légué, se trouve dans une position analogue à celle des bâtisseurs de jadis : faire du neuf avec du vieux, du contemporain avec de l’ancien. Une fonction qui se trouve au cœur même du mot auteur, qui vient du latin augere : accroître, augmenter. L’auteur, justifié par son étymologie, est donc celui qui construit en mêlant à la matière ancienne sa propre substance, mais aussi en exhumant les ressorts cachés du texte pour faire surgir le sens, mieux le déployer dans toute son étrangeté, sa vérité redécouverte et réappropriée. Autrement dit, mâcher le travail du lecteur pour mieux lui offrir l’héritage inestimable de nos pères.
Pourtant, lorsqu’on s’adonne à la récriture, on s’expose à deux sortes de reproches catégoriques. Le premier, conservateur : les œuvres du passé sont des monuments sacrés, bas les pattes ! Le second, sournois : récrire ne permet pas de créer une œuvre personnelle.
Régénérer l’universalité des vieux textes
J’ai reçu le premier de ces deux reproches, à Nantes, sournoisement, à la fin du siècle dernier. J’avais été invité, parmi d’autres écrivains et poètes, à une manifestation littéraire pour mon livre Le roman de Gilgamesh 1, paru l’automne précédent. La bibliothécaire qui m’avait accueilli me détaillait le programme qui m’attendait, quand, au cours de la conversation, elle me fit part de l’appréciation sur mon roman d’une consœur qui ne l’avait pas lu, mais seulement aperçu.
— Ces textes-

1 Le roman de Gilgamesh, Albin Michel, 1998.
2 Jean Bottéro (1914-
3 Jean Bottéro, op. cité, p. 230.231
4 Cf. Le poème d’Atrahasîs, ou du Supersage, in Lorsque les dieux faisaient l’homme, p. 526 à 601, Jean Bottéro, Samuel Noah Kramer, Gallimard, Bibliothèque des histoires, 1989.
L’élitisme , sous son jour le plus dédaigneux. Cette remarque avait beau me rassurer sur le fait que la parité, dans sa grande sagesse, n’avait pas oublié de répartir la sottise équitablement entre les hommes et les femmes, je fus tout de même pris au dépourvu. Être cueilli à ma quasi-
, sous son jour le plus dédaigneux. Cette remarque avait beau me rassurer sur le fait que la parité, dans sa grande sagesse, n’avait pas oublié de répartir la sottise équitablement entre les hommes et les femmes, je fus tout de même pris au dépourvu. Être cueilli à ma quasi-
Je ne savais pas exactement ce qu’on y attendait de moi. De plus, c’était la première fois que je prenais la parole à propos de ce livre et je n’étais pas très sûr de moi. Aussi, commençai-
Lire l’Épopée de Gilgamesh, brute de traduction, même celle, magistrale, de Jean Bottéro 2, requiert une solide expérience de la lecture, néanmoins insuffisante à élucider ses mystères. L’Épopée, en effet, est une vieille œuvre, altérée par de nombreuses lacunes, rédigée dans une langue qui parlait à ses contemporains en allusions, en connivences, dont on ne peut se faire une idée imparfaite et limitée tant ce vieux monde nous est étranger, que par des avertissements, des notes et un abondant appareillage critique explicatif. Ce qui implique une lecture hachée, sans cesse interrompue par des supputations et des questions qui trouvent rarement réponses.
Telles qu’en elles-
Car Gilgamesh nous parle de nous. Sa tendre amitié pour Enkidu, son intempérance, sa volonté de puissance, comme son désarroi devant la mort, ce sont les nôtres. Sa folle quête de l’immortalité, la prise de conscience de son erreur dans l’épuisante acceptation de son humanité, sa terrible reddition, ce sont également les nôtres. Seulement sa langue nous est étrangère. Il a besoin d’interprètes qui mettent au jour ces liaisons entre lui et nous, déchiffrent les similitudes et permettent aux lecteurs de saisir ces mains qu’il nous tend, lui en particulier, et les textes anciens en général. Faute de quoi, les fertiles expériences qu’ils nous content, demeurent ignorées du plus grand nombre.
L’universalité de ces vieux témoignages a donc besoin d’être régénérée.
Voici quelques exemples, puisés dans L’Épopée, afin d’étayer cette nécessité.
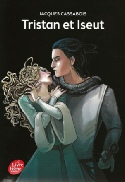 La première rencontre entre Gilgamesh et Enkidu est caractéristique. Rencontre tonitruante. Gilgamesh veut se débarrasser de ce rival, et pour être sûr de le vaincre, il commence par l’affaiblir en le civilisant, grâce à une femme, prêtresse d’Ishtar, déesse de l’amour, représentation du féminin sublimé, qui lui apprend à aimer comme les hommes. Ainsi, il brise son animalité de primitif de la steppe, compagnon des gazelles.
La première rencontre entre Gilgamesh et Enkidu est caractéristique. Rencontre tonitruante. Gilgamesh veut se débarrasser de ce rival, et pour être sûr de le vaincre, il commence par l’affaiblir en le civilisant, grâce à une femme, prêtresse d’Ishtar, déesse de l’amour, représentation du féminin sublimé, qui lui apprend à aimer comme les hommes. Ainsi, il brise son animalité de primitif de la steppe, compagnon des gazelles.
Quand ils sont face à face, ces deux colosses se battent sans merci, et Gilgamesh est généralement désigné comme le vainqueur de cette empoignade. Curieuse victoire, bien loin d’être probante, si l’on se réfère au texte. En effet, la fin du combat, emballée en quelques vers absents de la version classique (fin du deuxième millénaire avant JC) – le style de l’Épopée est un modèle de concision –, figure seulement dans un fragment plus ancien, dit tablette de Philadelphie, antérieure au milieu du deuxième millénaire.
La voici restituée en ses termes lapidaires, par le traducteur :
Lorsque Gilgamesh
Ploya,
Immobilisé,
Sa colère tomba
Et il céda 3.
C’est tout ce que l’on sait de l’issue de cette bagarre de géants, dont le récit est par ailleurs tout aussi sobre et laisse sur sa faim le lecteur contemporain rompu par la littérature, le cinéma, et parfois son expérience personnelle, à des récits d’affrontements autrement plus méticuleusement développés.
Une note accompagne le dernier vers et précise le sens de « il céda », par la traduction littérale suivante : « il détourna la poitrine ».
J’ai longtemps hésité sur cette note. Que l’invincible Gilgamesh ploie, puis cède en détournant la poitrine, me semblait signifier clairement qu’il rompait l’engagement. Un quasi-
Pourtant, dans la strophe suivante, le poème nous montre Enkidu reconnaissant la suprématie du roi d’Uruk. Pourquoi cette allégeance soudaine ? Que s’est-
Or cette énigme est un carrefour du récit, car c’est à cet instant précis que débute la fabuleuse amitié entre les deux hommes.
L’aube de l’homme
 Il n’était pas simple pour moi, candide, de donner la victoire à Enkidu et d’aller ainsi à l’encontre de l’opinion généralement admise par tant d’épigraphistes avisés. Pas évident de transgresser les usages en m’appuyant sur un seul mot, certes choisi avec un soin extrême par un illustre spécialiste, lequel, par cet éclairage nouveau, nous suggérait peut-
Il n’était pas simple pour moi, candide, de donner la victoire à Enkidu et d’aller ainsi à l’encontre de l’opinion généralement admise par tant d’épigraphistes avisés. Pas évident de transgresser les usages en m’appuyant sur un seul mot, certes choisi avec un soin extrême par un illustre spécialiste, lequel, par cet éclairage nouveau, nous suggérait peut-
L’ancien sauvage, vainqueur de fait, renonce donc à sa victoire, intimidé par la supériorité de son rival civilisé. Dans cette relation entre les deux hommes, j’entendais un écho de la lointaine concurrence qui a longtemps opposé homo erectus à homo sapiens, pour s’achever par l’extinction du premier.
Enkidu, pensais-
Sa décision nous ramène à l’aube de l’homme et nous plonge au cœur des grands drames de l’évolution. Porteur de toute cette hérédité, le bon Enkidu devient alors émouvant à pleurer.
Il me plaisait de concevoir leur amitié naissante sous ces augures magnifiques, et j’ai beaucoup supputé, beaucoup rêvé avant de franchir ce Rubicon, éclairé par la lueur de ces simples mots : « il céda ».
Restait ensuite à rendre ce dilemme en l’écrivant. Cette fraction de seconde où tout s’illumine, où le passé et l’avenir se rejoignent, ce choix nourri par la lutte physique, le contact des corps, l’odeur des chairs au plus fort de l’envie de terrasser l’autre, ce désir de mort mêlé à la rage de triompher que le vieux texte ne dit pas, c’est la part de l’auteur contemporain tenu d’en faire ressentir toute la puissance tragique, parce qu’il s’est identifié aux personnages à l’aide de sa sensibilité, de son expérience de la vie, parce qu’il est descendu lui-
L’auteur, par ses accroissements, apporte ainsi une dimension que le texte ancien garde dissimulée au cœur de ses symboles, de ses soupirs, de ses silences. Réfuter la légitimité d’une telle intervention est incompréhensible.
L’arche et ses énigmes
Autre exemple, encore plus probant, le récit du Déluge, qui impose à l’auteur d’impératifs choix d’interprétation en vue d’une lecture éclaircie.
Cet épisode nous raconte comment les dieux, excédés par le trop grand pullulement des hommes et par leur bruit, ont décidé de les anéantir sous un déluge d’eau. Un dieu pourtant est d’un avis contraire : Ea l’ingénieux, le dieu technicien. Il voit loin. Il sait que les dieux ont besoin des hommes 4, mais ne peut faire entendre raison à ses collègues. Aussi, décide-
Il alerte donc son favori, lui dicte la conduite à tenir et lui ordonne de construire une arche, selon des dimensions et un plan précis, afin qu’il puisse, le moment venu, s’y mettre à l’abri avec sa famille et attendre la fin de la catastrophe.
 Au nombre de ses conseils, figure l’énigmatique manière de calfater l’embarcation.
Au nombre de ses conseils, figure l’énigmatique manière de calfater l’embarcation.
Uta-
Sur cette répartition, le traducteur apporte en note, une précision :
« On voit mal, dit-
Uta-
D’un point de vue raisonné donc, cette réserve servait à éviter d’alerter les futures victimes de leur fin programmée et imminente. Une pure diversion, en somme.
Cette explication, pour fondée qu’elle fût, ne me satisfaisait pas. Je pensais qu’il fallait regarder ces quantités de la même manière que les dimensions de l’arche et son organisation en sept étages de neuf compartiments, d’un point de vue symbolique. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les trois nombres, 36, 72 et leur somme 108, représentaient respectivement le ciel, la terre, et l’homme. Des valeurs qui s’ajustaient parfaitement à la fonction de l’arche.
Ainsi, les proportions du bitume nous renseignaient à voix basse, à l’instar d’Ea, et comme pour ne pas trahir son secret, sur l’ouvrage qui attendait Uta-
Cet enjeu formidable, l’arche allait en être le creuset. Car c’était à l’intérieur de ce coffre (arca), que le trésor de l’humanité régénérée serait placé en gestation, avant l’heure de son essor sur une terre lavée des traces de la vieille humanité caduque.
Cette coïncidence ne pouvait pas être fortuite. Elle était bien la volonté du génial scribe Sinleqe’unnenni, traduit par :
O-
Les exemples de cette sorte abondent dans l’Épopée de Gilgamesh. Mais une fois ces découvertes opérées, il me restait à les mettre en œuvre, excité par l’envie de les partager, de les rendre perceptibles, dans un texte qui n’avait rien d’explicatif, tel un cours ou une conférence, mais dans une prose sensible, qui permettrait à chacun de vibrer, de rire, de s’émouvoir, de s’enthousiasmer, de réfléchir sur soi, de se laisser envahir par la quête des personnages, de les regarder au cœur, en acceptant d’être bouleversés de leur ressembler.
C’est ce pari-
Pages… 1 ~ 2